Autant d’enseignements ciblés, notamment par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en octobre dernier, qui les range dans une doctrine « islamo-gauchiste » qui ferait, selon lui, des ravages au sein des universités. Ou encore par la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui souhaite carrément lancer une enquête sur un concept jugé problématique.
Rue89Lyon avait déjà consacré une enquête à l’identité de cette université lyonnaise.
On a discuté de cette situation inédite avec Nathalie Dompnier, présidente de Lyon 2, réélue pour un nouveau mandat le 5 février. Comment sont orientés les choix budgétaires ? Au-delà de cette question à enjeu politico-médiatique de l’ »islamo-gauchisme », nous avons abordé celle du militantisme (la gestion des blocages notamment). De l’avenir et des projets (avec un Learning center à venir, par exemple). Mais aussi, bien sûr, de la crise sanitaire et de ses conséquences lourdes chez les étudiants.
Tour d’horizon des sujets qui monopolisent aujourd’hui l’attention -pour le moins.
Rue89Lyon : À Lyon 2, on peut suivre des formations sur les études de genre, les études décoloniales… En octobre dernier déjà, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, accusait certaines universités de promouvoir une vision du monde « islamo-gauchiste » avec certains enseignements.
Aujourd’hui, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s’y met. Vous êtes professeure de sciences politiques alors je vous pose la question : l’« islamo-gauchisme », c’est quoi ?
« On pourrait peut-être encore créer un terme : le féminismo-islamo-gauchisme ? »
Nathalie Dompnier : Je ne sais pas. C’est un terme de disqualification. D’ailleurs, le CNRS a très bien répondu à la demande d’enquête de la ministre en disant qu’il n’était pas compétent, que ce n’était pas un terme scientifique.
On peut associer comme ça toutes sortes de tendance.
Pour les études sur le genre, on pourrait peut-être encore créer un terme : le féminismo-islamo-gauchisme ?
On a des champs de recherche qui se développent dans les sciences sociales, qui peuvent déranger à certains égards politiques. Mais ils sont tout à fait légitimes du point de vue scientifique.
Par exemple s’interroger sur les inégalités, les discriminations de genre, les phénomènes de racialisation…

Étudier le genre et la race, en quoi ça consiste ?
Sur les études de genre, on observe des discriminations et des inégalités. Mais en amont, il y a une sociabilisation différenciée qui fait que les hommes et les femmes se voient attribuer des rôles distincts dans les sociétés, qui produisent des rapports au monde différents, des statuts différenciés. D’une société à l’autre, on a des constructions sociales différentes des rapports de genre.
Le terme de racialisation quant à lui est intéressant. C’est la manière dont on assigne socialement un certain nombre de caractéristiques à des personnes en fonction de leur appartenance de race supposée.
Attention, les sciences sociales ne disent pas qu’il y a des races qui auraient des caractéristiques propres, l’objet c’est d’analyser le phénomène social par lequel on assigne ces caractéristiques.
Il y a débat au sein des sciences sociales sur ces sujets-là. Certains vont parler de races, d’autres d’ethnies, d’autres de racialisation…
Tout ça permet d’interroger le monde qui nous entoure. Ce sont des outils, des clefs de lecture, des lunettes qui permettent de lire et d’essayer de décrypter un certain nombre de phénomènes sociaux. Comme par exemple les phénomènes de discrimination à l’embauche.
On va pouvoir analyser ce qui se produit et ce qui explique ces formes de discrimination, ce qui explique aussi un certain nombre de comportements. Parfois de l’auto-censure…
« Lyon 2 est visée par les ministres comme Montpellier 3 ou Rennes 2 qui sont aussi des universités de sciences sociales… »
Du fait de ces choix d’enseignements, est-ce que vous avez senti Lyon 2 visée particulièrement par ces accusations d’ « islamo-gauchisme » ?
Je dirais que ce sont les sciences sociales qui sont visées. Donc oui, Lyon 2 est visée mais de la même manière que Montpellier 3 ou Rennes 2 qui sont aussi des universités de sciences sociales…
Lyon 3, par exemple, n’est pas une université de sciences sociales : on est beaucoup moins sur ces enjeux de société brûlants.
Les formations sur le genre, typiquement, sont pluridisciplinaires. On a de la sociologie, de l’histoire, des lettres, donc c’est vraiment une approche thématique très large.
Dire qu’on aurait un courant comme ça qui gangrènerait nos formations, c’est complètement aberrant. Ces formations sont d’une diversité extrême. Ce n’est pas très sérieux, c’est une méconnaissance assez profonde de ce que sont nos formations.
Quel est l’intérêt pédagogique d’enseigner ces matières-là aux étudiant.es ?
Nous ne sommes pas dans une perspective politique. On analyse des faits sociaux et des discours. Parmi ces discours, il y a des discours d’affirmation de la République par exemple, de l’égalité des chances, de l’égalité formelle entre toutes et tous, quelle que soit la couleur de peau, le statut social etc. Ça, c’est une posture politique, idéologique.
Il existe en revanche des idéologies et des postures politiques qui revendiquent une différence des races, et des sexes d’ailleurs, qui seraient là par nature : c’est le racisme. Ce n’est pas le rôle de l’université de dire s’il convient ou non d’adhérer à telle ou telle idéologie. Chacun a sa conscience.
Ce qui nous intéresse c’est le discours, la construction, la diffusion dans une société de ces discours. C’est aussi interroger et analyser ce qui se passe dans la société. Y compris dans une société régie par un principe d’égalité formelle, d’affirmation d’une République qui accorde les mêmes droits à toutes et tous – principes auxquels on peut adhérer, ce n’est pas la question.
De fait, si on prend le temps d’observer ce qui se passe, on voit bien un décalage entre ce discours et les rapports sociaux qui nous révèlent des inégalités et des discriminations. Il nous faut aussi analyser dans quelle mesure ces phénomènes sont présents dans une société, comment ils évoluent, sur quelles représentations ils reposent, qu’est-ce qu’ils produisent en termes de ségrégation sociale, spatiale…
Ça, c’est notre objet de recherches et l’enjeu est de mieux comprendre la société, d’être en mesure de l’analyser. Et qu’est-ce qu’on fait avec ça ? D’abord, on ne se voile pas la face sur ce qu’est la vie de nos sociétés.
Selon vous, pourquoi ça coince aujourd’hui et qu’est-ce qui motive la critique de ces enseignements-là en particulier ?
Ce n’est pas la première fois que ça coince. Il y en a eu des débats, à d’autres périodes. Dès que l’on étudie les questions de société, on bouscule des représentations et des a priori.
Ce qui se passe actuellement, c’est une joute politique, qui prend entre autres pour terrain l’université. Ça se joue sur le dos de l’université, d’une certaine manière. On voit aujourd’hui des débats politiques autour des formes d’islam radical, autour de la manière dont un certain nombre de courants de gauche se radicalisent de manière très forte. Ça fait longtemps déjà qu’on a ces interrogations.
D’ailleurs un de ceux qui estiment qu’on a affaire à des formes d’islamo-gauchisme s’est expliqué récemment : Pierre-André Taguieff expliquait qu’il avait forgé ce terme après avoir constaté qu’il y avait des rapprochements de fait de certains de ces courants.
On est ici dans le registre politique et il ne revient pas à l’université de valider ou non ces éventuels rapprochements. Ces enjeux politiques sont là actuellement. Et un certain nombre d’analyses scientifiques portent sur des objets qui intéressent ces mouvements ou tendances politiques. Qui les intéressent ou qui les dérangent.
Comment se fait ce choix d’enseigner les études de genre, de consacrer un TD (« travaux dirigés ») aux études décoloniales dans une université ?
On a de nouvelles tendances et de nouveaux courants qui émergent régulièrement dans les laboratoires de recherche. De nouvelles thématiques apparaissent car elles correspondent à des préoccupations à un moment donné, dans la société, à des phénomènes sociaux que l’on n’observait pas forcément avant ou qu’on ne voyait pas.
Par exemple, sur les études de genre, en France ça a été relativement tardif. Mais dans beaucoup de pays, elles se sont développées plus tôt, à un moment où se posait la question des droits des femmes, de l’égal accès des femmes à un certain nombre de situations sociales. C’est lié à des mouvements de fond de la société, à des revendications également.
Ce n’est pas pour autant que la recherche elle-même va se positionner dans une perspective revendicative. Ces observations vont amener certains nouveaux sujets de recherche sur lesquels on souhaite pouvoir se développer.
On va être amenés à recruter un enseignant-chercheur qui, du fait de son profil, pourra venir contribuer à la vie du labo sur cette thématique.
Nos enseignants, et c’est une chance, sont des enseignants-chercheurs. Nos enseignements, c’est une chance aussi, sont ancrés dans la recherche en train de se faire.
C’est une des caractéristiques de l’université par rapport à d’autres formations de l’enseignement supérieur.
« Le financement des enseignements ne va pas dépendre de la thématique »
Tous les thèmes sur lesquels des recherches sont faites sont-ils forcément traduits en cours à l’université ? Comment choisit-on ceux qui vont être enseignés aux étudiant.es ?
Non, pas forcément. Au niveau licence, on a de grands cours traditionnels qui permettent d’acquérir les bases dans une discipline. En sociologie par exemple, on va reprendre les structures sociales, l’évolution des sociétés contemporaines etc. C’est indispensable, c’est la base.
C’est souvent à partir de la troisième année de licence, et surtout au niveau des masters qui sont adossés à des labos de recherche.
Il y a une dimension de formation à la recherche et par la recherche en master.
Là, effectivement, on aura des cours généraux et des séminaires directement en lien avec les spécialités des enseignants-chercheurs et des labos auxquels ils appartiennent.
Certains masters ont plus de spécialités que d’autres. Dans les études de genre, Lyon 2 propose sept parcours de master. Comment se font ces choix budgétaires d’investir dans certaines disciplines plutôt que d’autres ?
Le financement des enseignements ne va pas dépendre de la thématique. On va raisonner en fonction du nombre d’étudiant.es attendu.es et donc on va accorder une enveloppe budgétaire, un nombre d’heures… Sur les formations déjà existantes, on a l’historique, on connaît le nombre de candidatures, le nombre d’étudiant.es des années précédentes.
Ouvrir des nouveaux parcours dans un master, cela suppose un nombre d’étudiant.es suffisant mais il y a aussi un tronc commun.
Sur les études de genre par exemple, il y a une demande des étudiant.es mais aussi une demande très forte des entreprises. De plus en plus, chez les DRH des grandes entreprises, il y a justement des métiers liés à la lutte contre les inégalités hommes-femmes. On n’est plus du tout sur l’islamo-gauchisme, là !
C’est intéressant de voir que ces formations qui sont aujourd’hui pointées du doigt intéressent éminemment les acteurs de notre société. Pas d’un point de vue politique mais très pratique car ce sont des formations qui répondent à des enjeux que rencontrent ces acteurs.
« On a une formation intellectuelle et critique qui va, pour certain.es, les conforter dans leur action militante »
À Lyon 2 existe une vie militante assez forte de longue date. Vous avez été élue dans le contexte de la loi Travail, puis il y a eu la loi ORE, Parcoursup… Que pensez-vous de ce militantisme étudiant ?
Il faut faire attention, c’est assez aisé à 50 ou 60 de bloquer un campus. Au total, on a 29 000 étudiant.es donc il faut aussi regarder de quelle proportion on parle.
On a une partie des étudiant.es qui est militante, parfois très militante, que ces sujets de société intéressent et qui vont nourrir leur réflexion militante à partir de ce qu’ils peuvent apprendre à l’université.
Ensuite, chacun.e se forge ses opinions et ses manières de penser à partir de différentes sources.
On a des bachelier.es déjà très ouvert.es sur le monde qui les entoure, ce n’est pas par hasard s’ils et elles choisissent les sciences sociales et puis on a une formation intellectuelle et critique qui va, pour certain.es, les conforter dans leur action militante.
Encore une fois, les formations sont variées et nos étudiant.es en font aussi ensuite ce qu’ils et elles voudront. On a aucune maîtrise dessus. On peut produire et diffuser du savoir, ensuite il est à la portée de tous et toutes et c’est très bien. Heureusement !
Sur les mouvements étudiants, je peux vous dire d’expérience qu’il n’ont pas été menés que par des étudiant.es de Lyon 2 à Lyon 2. On a aussi les étudiant.es de Lyon 3, de l’ENS… Mais Lyon 2 est un peu le point de ralliement. C’est vrai : on a une tradition de mouvements étudiants dans cette université.
Comment concilier cette vie militante des étudiant.es et la continuité de l’université ?
Sur la gestion des mouvements étudiants, on peut montrer les dents et réagir de manière dure. Ça ne ramène pas forcément la paix sociale. On peut discuter et essayer de faire en sorte que les mouvements se déroulent le mieux possible -et dans le respect des activités de l’université.
Personnellement, je pense qu’en bloquant une université, on bloque aussi un formidable outil d’émancipation. Les savoirs qu’on y dispense sont aussi émancipateurs.
Il n’y a donc pas de bonne réaction ?
Ça dépend du contexte. Parfois, il y a eu des amphis mis à disposition, c’était une manière d’éviter le blocage. C’est toujours une gestion de crise où on trouve la réponse la plus appropriée selon la lecture qu’on peut avoir de la situation à un moment donné.
Ensuite, c’est vrai qu’on peut toujours considérer en dernier recours l’évacuation de l’université par les forces de l’ordre.
On a été amené à le faire en 2018, sur un moment de la mobilisation sur Parcoursup parce qu’il se passait des choses qui, à mon sens, étaient vraiment problématiques dans l’université. Ce n’était pas que des étudiant.es qui étaient là, à occuper un amphi. On avait une population assez variée, des gens qui très clairement étaient là pour faire de l’agitation en s’appuyant sur le mouvement étudiant mais qui n’avaient pas grand chose à voir avec.
Sur les occupations nocturnes, on a un étudiant qui s’est défenestré de nuit. À ce moment-là, on sévit. On ne peut pas laisser investir les lieux de cette manière, c’est dangereux.
L’enjeu est de trouver des équilibres, de faire en sorte que les revendications politiques puissent s’exprimer sans nuire aux missions de l’université.
« Les tentatives de suicide sont nombreuses, elles ne datent pas de janvier »
Depuis la crise sanitaire et la fermeture des universités, la situation des étudiant.es est particulièrement compliquée. Beaucoup se retrouvent en situation de détresse psychologique, financière. Récemment, l’actualité a été marquée par la tentative de suicide de deux étudiant.es de Lyon 3.
C’est quand même assez étonnant, ces tentatives de suicide de deux étudiant.es de Lyon 3 qui ont provoqué subitement une prise de conscience.
Ça fait des mois qu’on tire la sonnette d’alarme ! La conférence des présidents d’université l’avait déjà fait à l’automne.
Les tentatives de suicide sont nombreuses, elles ne datent pas de janvier, avec aussi parfois des suicides.
On ne va pas tout mettre sur le dos de la crise sanitaire. On ne connaît pas les motivations. Il y avait des tentatives de suicide et des suicides d’étudiant.es, une détresse, un mal-être et une précarité avant. Et qui ont été accentués par la crise.
Quelles mesures avez-vous prises pour les étudiant.es pendant la crise sanitaire ?
Ce qui a été fait pendant la crise sanitaire, c’est un accompagnement pédagogique, social, médical et de santé mentale pour les étudiant.es.
Sur l’accompagnement pédagogique, très tôt, en mars, on a fait une enquête auprès des étudiants pour savoir s’ils avaient le matériel pour suivre les cours à distance.
On a fait des bons d’achat pour des ordinateurs et envoyé des cartes SIM pour la connexion internet. On a relancé cette opération à la rentrée, cette fois-ci avec des bons d’achat mais aussi des prêts d’ordinateurs et des dons d’ordinateurs.
« Un projet de service de santé mentale pour les étudiant.es verra le jour »
Et au niveau du médical et de la santé mentale ?
On avait une psychologue à 80%. Là, on en a embauché un deuxième début février car notre psychologue était complètement débordée. Le financement du gouvernement pour embaucher des psychologues, on l’attend toujours.
À un moment, on s’est dit que les étudiant.es en avaient besoin et qu’on n’allait pas attendre davantage.
Le service de santé universitaire a été super pendant toute cette période. Pendant le confinement, ils faisaient des consultations par téléphone, et dès que ça a été possible, on a repris des consultations sur site.
Les médecins généralistes des services de santé universitaire de Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 travaillent ensemble. Là, ils sont en train de monter un projet de service de santé mentale pour les étudiant.es, qui verra le jour dans quelques temps.
Je pense que cette idée était déjà là avant, mais la crise sanitaire et les problèmes de santé mentale, l’isolement et tout ce que ça génère pour nos étudiant.es, ont contribué à accélérer le projet. Ce serait pour tous les étudiant.es des universités et des écoles de la métropole de Lyon.
Et au niveau social ?
Du point de vue des aides sociales, il faudra être vigilant. Un.e étudiant.e boursier.e a un nombre d’années limitées pour faire sa licence ou son master.
On risque d’avoir des étudiant.es qui ont peut-être décroché cette année mais qui pour autant n’ont pas abandonné leur projet d’études et qui vont revenir – on l’espère – à la rentrée prochaine, en ayant perdu une année. On a aussi des étudiant.es qui ont été ralenti.es dans leur cursus, parce qu’ils et elles étaient en alternance et n’ont pas pu avoir de contrat pendant cette période.
Est-ce qu’il y aura des aides financières pour ces étudiant.es-là du côté de leur université ?
À mon initiative, on a créé des aides complémentaires à celles du CROUS avant la crise, individuelles et qui viennent couvrir des besoins qui ne le sont pas forcément par les aides du CROUS.
On n’a pas les moyens – et ce n’est pas notre mission – d’aller au-delà, c’est la mission du CROUS.
Pour moi, il y a une discussion à avoir avec le ministère et le CNOUS sur les modalités de prolongation des bourses pour les étudiant.es, pour éviter que certain.es se retrouvent en difficulté.
« Je ne sais pas encore quel a été le taux d’abandon »
Est-ce que des dispositifs sont prévus pour récupérer les étudiant.es qui auraient décroché pendant la crise sanitaire ?
On est en train de réfléchir à la rentrée de septembre 2021, pour voir quel type de dispositif de remédiation on pourra mettre en place pour accompagner les étudiant.es.
Je ne peux pas vous donner de chiffres parce qu’on est en train de faire les jurys du premier semestre. Donc je ne sais pas encore quel a été le taux d’abandon. On a reporté les jurys pour laisser un peu de mou aux équipes pédagogiques. On avait prévu de faire revenir les « première année » sur site, et de laisser les autres à distance.
Les enseignant.es ont prévu cette organisation pédagogique, et tout d’un coup on leur a dit que les autres pouvaient revenir aussi. C’est ça qui a semé le bazar, sachant que c’est quand même la cinquième organisation pédagogique depuis le début de l’année. Ce qui explique le retard sur les jurys. Mais il faudra regarder de près ce que ça donne.
Ce semestre, on a le dispositif de tutorat qui se met en place. On avait une plateforme mais c’était de l’accompagnement au travail. Là, on peut être davantage sur du disciplinaire, sur des formations précises, avec des étudiant.es en master. Il faudra sans doute avoir un accompagnement pour les étudiant.es en début d’année universitaire 2021.
« Beaucoup ont appris, d’un point de vue technique mais aussi pédagogique dans la conception d’un cours à distance »
Quels enseignements tirez-vous de cette période particulière ?
Sur les choses qui vont rester, peut-être positives, on a beaucoup progressé sur l’enseignement à distance. Y compris des collègues qui, comme moi, n’avaient pas une appétence très forte pour cela.
Beaucoup s’y sont mis et ont appris, d’un point de vue technique mais aussi pédagogique (dans la conception d’un cours à distance). Ça nous permet de penser un certain nombre de formations spécifiques pour de publics éloignés ou empêchés, qui n’ont pas la possibilité de venir à l’université. Pas forcément du tout-distanciel, parce qu’on voit dans les travaux des sciences de l’éducation qu’il n’est pas du tout préconisé. Mais une partie en distanciel, avec des regroupements ponctuels par exemple.
Il y a quelques semaines, on a déposé deux projets de campus connectés, avec deux communautés de commune. Sur notre prochaine offre, des formations seront proposées soit sur site, soit à distance pour des publics qui ne peuvent pas venir à l’université.
Il y a autre chose qui va rester, et qu’il faudra poursuivre au-delà de la crise sanitaire, c’est l’équipement des étudiant.es pour l’enseignement à distance. C’est un outil indispensable. On ne peut plus étudier aujourd’hui sans un minimum d’équipement numérique. Dans les cours en présence, sur site, on met à disposition des ressources en ligne… Il faut qu’on arrive à suivre.
La crise a donc forcé un peu Lyon 2 à se moderniser ?
Oui, en tout cas à accélérer un processus d’accroissement de la place du numérique. Je pense qu’avant la crise, on avait sans doute des étudiant.es en difficulté du fait de leur mauvais équipement informatique. Là-dessus, il faut qu’on arrive à progresser.
Est-ce que c’est le rôle de l’université ? On a réussi à tenir un peu ce pari. On a contacté tous les étudiant.es et on a équipé tous ceux qui nous ont fait un retour. Je pense qu’il faut continuer.
« Nous avons un projet d’envergure qui est la transformation du campus Porte des Alpes avec le Learning Center »
Vous avez été réélue le 5 février pour un nouveau mandat en tant que présidente de Lyon 2. Quels sont les grands projets pour les quatre années à venir ?
Nous avons un projet d’envergure qui est la transformation du campus Porte des Alpes avec le Learning Center : un espace ressource au sein de l’université, pour l’ensemble des étudiants et des collègues, avec la BU (bibliothèque universitaire, ndlr), le service universitaire d’orientation et d’insertion professionnelle, le guichet des services numériques, le service de pédagogie du supérieur pour les enseignants plutôt, des salles de travail en libre accès pour les étudiants, des salles pour travailler en groupe…
En 2016, quand je suis arrivée, le financement n’était pas stabilisé donc il a fallu le faire. Les travaux vont pouvoir commencer, la BU provisoire est déjà construite.
Nous sommes aussi en pleine conception d’une prochaine offre de formation, commencée sous le précédent mandat. Elle sera mise en œuvre en septembre 2022 avec plus d’individualisation des parcours dès le niveau licence, jusqu’à présent très formaté.
On veut laisser aux étudiants davantage de choix pour correspondre à leur projet professionnel. Il y a aussi le développement de la science ouverte qui nous est cher, avec la mise à disposition au plus grand nombre, gratuitement, des travaux de recherche de l’établissement.
Dans les nouveaux projets, nous allons bientôt nommer une nouvelle vice-présidence « sciences et société ». L’objectif est de renforcer les liens entre nos activités académiques et les enjeux de société, les attentes des acteurs socio-économiques, culturels, institutionnels…
La formation tout au long de la vie, la recherche participative, partenariale, la possibilité aussi pour nos étudiants de lier les expériences de recherche et de professionnalisation avec des acteurs socio-économiques. C’est une tendance qui se développe internationalement, on s’inspire beaucoup de ce qui se fait au Québec, la recherche au service de la collectivité, de la société.
On est en train de constituer un réseau d’universités qui souhaitent investir dans cette troisième mission de l’université : formation, recherche et diffusion auprès de la société et de ses acteurs. C’est l’un des gros projets de ce mandat.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.
En 2025, nous faisons face à trois menaces :
- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.
- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.
- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.
Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.
En 2025, nous faisons face à trois menaces :
- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.
- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.
- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.
Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous


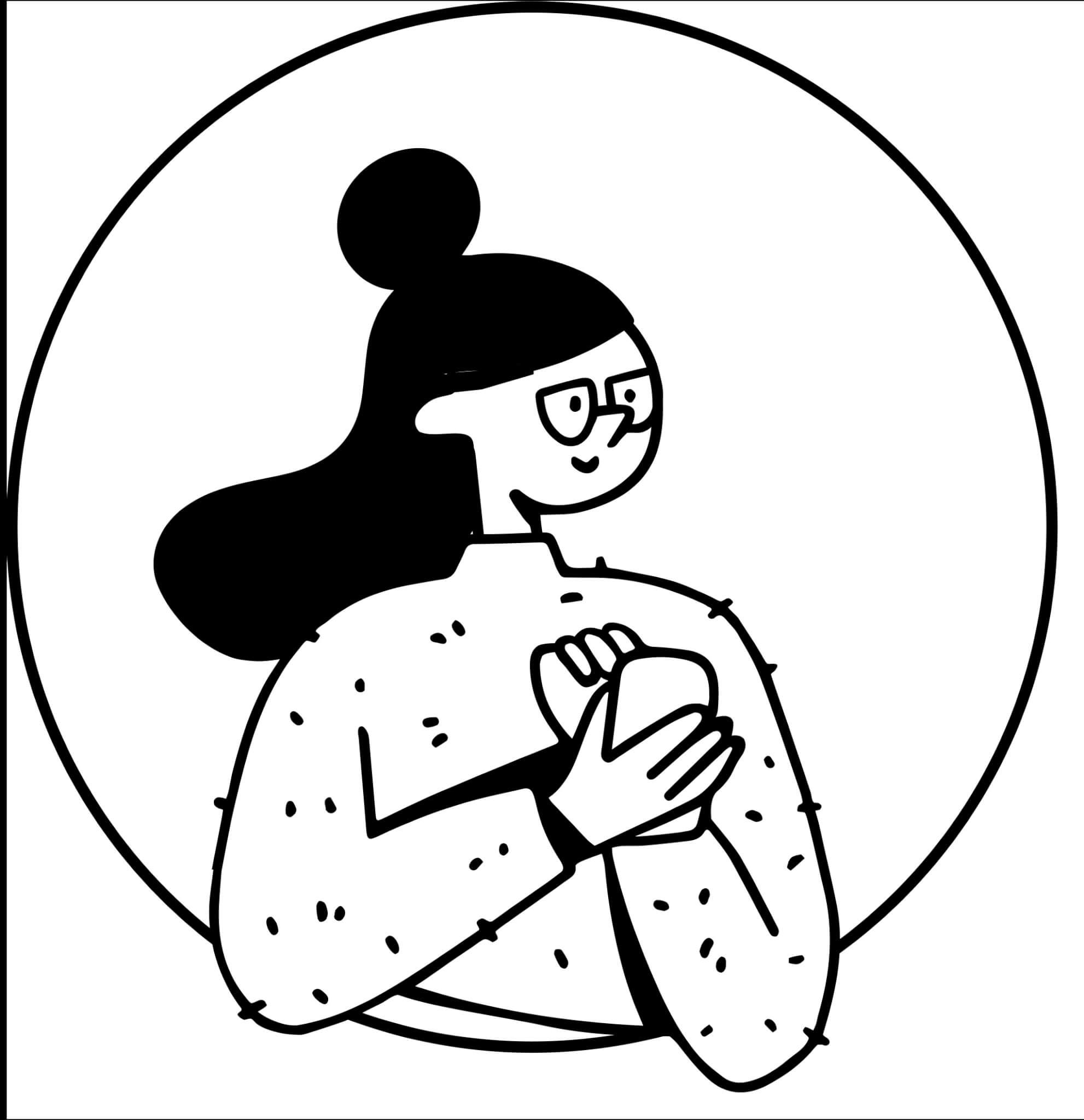







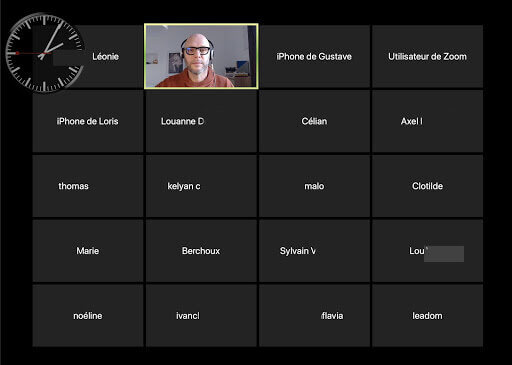


Chargement des commentaires…