Entre l’Autriche et Washington, il lance un jeune Delon peu connu aux USA aux trousses d’un Lancaster vieillissant dans une histoire d’espionnage dure et implacable servie par une épatante brochette de seconds rôles.
Bande de scorpions
Entre deux polars avec son acteur fétiche Charles Bronson, « Le flingueur » (1972) et « Le cercle noir » (1973), le réalisateur anglais Michael Winner va trouver le temps de mettre en chantier un projet proposé par United Artists intitulé « Dangerfield ».
Il y est question d’un agent de la CIA en fin de carrière soupçonné de trafiquer avec les soviétiques et aux trousses duquel ses supérieurs vont lancer un tueur professionnel qui fut jadis son élève.
Si l’idée du vieux pro traqué par sa meilleure recrue, ou l’inverse, sent un peu le réchauffé en 2019, c’est encore assez nouveau en 1972 pour que United Artists accorde toute sa confiance et un joli budget à Michael Winner.
Au point que lorsque ce dernier, connu pour son caractère ombrageux, va quitter le projet pour une divergence de vue avec le producteur multi-oscarisé Walter Mirisch, ce dernier sera débarqué de la production (tout en gardant son nom au générique) au profit du britannique.
Le nom « Dangerfield » ayant déjà été déposé, Winner va devoir trouver un autre titre à cette histoire, développée par son scénariste habituel, Gerald Wilson. Manifestement, l’inspiration n’est pas au rendez-vous :
« Je suis du signe du Scorpion, raconte le réalisateur dans ses mémoires. Burt Lancaster était un Scorpion typique, avec des accès de colère mais beaucoup de chaleur. Alain Delon était Scorpion tout comme Walter Mirisch, notre producteur. Alors, nous avons tout bonnement décidé d’appeler Scorpio le tueur incarné par Delon et d’intituler le film Scorpio. »
Cross, vieil agent fatigué qu’on soupçonne d’être double, ou Jean Laurier alias Scorpio, tueur français imperturbable et joueur qui connait si bien sa cible pour en avoir été l’élève, qui l’emportera ? Les codes du genre sont un peu bouleversés, le gentil pourrait être un traître quand le méchant pourrait avoir un cœur.
Car il s’agit avant tout de deux hommes, deux amis, contraints de s’affronter sans l’avoir décidé et pour des motifs qui leur échappent.
L’un pour sauver sa peau, l’autre parce qu’on le manipule. Le portrait de la CIA n’est ainsi pas flatteur, où l’on manigance à tous les étages en toute impunité et où les ennemis se situent moins dans le bloc de l’Est que dans le bureau d’à côté. Un constat typique du cinéma américain des années 70.
« Il y a une pièce secrète sous le bureau de McLeod (le boss de la CIA), raconte ainsi Cross à son ami Laurier, où des grands garçons jouent à un jeu. Ça ressemble au Monopoly sauf que des gens se font tuer. Il n’y a pas de bons, ni de mauvais. Le but n’est pas de gagner, mais de ne pas perdre. Et la seule règle à suivre est de rester dans le jeu ».

Des canaris et des chats
Dans le rôle de Cross, l’agent de la CIA aux supposées fréquentations douteuses, Burt Lancaster est assez touchant. Solide et impitoyable, il incarne toutefois magnifiquement bien toute la lassitude de son personnage pour cette vie de trahisons, de faux-semblants, pour ce monde qui change où il n’a plus sa place. Face à lui, Scorpio évoque une version plus énergique et moins contemplative d’un autre tueur incarné par Delon, Jeff Costello dans « Le samouraï » (Jean-Pierre Meville, 1967). L’un aimait les canaris, l’autre adore les chats. Les deux sont fascinants de froideur et de maîtrise.
Paul Scofield, brillantissime acteur anglais (Oscar en 1966 pour « Un homme pour l’éternité »), sera d’abord envisagé pour le rôle de Cross avant d’hériter de celui de Zharkov, l’agent du KGB nostalgique et philosophe qui refait le monde, avec Cross une bouteille de vodka dans chaque main et fustige les nouveaux espions, (« des pousseurs de boutons, gardiens de machines, des quincaillers aux jouets compliqués et qui se ressemblent tous, qu’ils soient de l’Est ou de l’Ouest »).
Gayle Hunnicutt incarne la petite amie de Delon, un rôle que l’on croit secondaire mais qui s’étoffera intelligemment jusqu’au dénouement.
Dans la catégorie « on les a vu partout mais on sait jamais comment ils s’appellent », JD Cannon et John Colicos héritent des rôles peu reluisants de deux bureaucrates de la CIA obsédés par leurs ambitions personnelles. Mention spéciale enfin pour Shmuel Rodensky, qui dans le rôle du vieil ami juif de Cross, violoncelliste boiteux sauvé par Cross d’un camp d’extermination nazi, apporte au film quelques touches d’une belle émotion et d’une profondeur bienvenues.
Ce joli casting enfin réuni, le tournage peut commencer à Washington en juin 1972. Fait plutôt rare, la CIA accepte d’accueillir Winner et son équipe dans ses célèbres bâtiments de Langley (Virginie), notamment grâce à l’influence du démocrate Burt Lancaster qui fera jouer quelques relations dont un certain sénateur Tunney qui a ses entrées à la CIA.
Pas de doublures
En 1972, Burt Lancaster a cinquante-neuf ans et Alain Delon, trente-sept. Autant dire que le second est supposé courir plus vite que le premier. Il n’en sera rien. La course poursuite dans le chantier du métro de Vienne en Autriche peut encore donner des complexes à Jason Bourne, où les deux acteurs, non doublés, courent au milieu des voitures, sautent sur des échafaudages, escaladent des murs et des grues, tombent, rampent, suants et haletants. Si Delon se déplace avec l’élégante énergie d’un grand félin, Lancaster, qui dans sa jeunesse fut un acrobate de cirque, a conservé une carrure d’athlète. « Burt était déterminé à exécuter lui-même le plus de cascades possible, se souvient Michael Winner, et Delon s’amusait de tout. »
On n’en revient tout simplement pas de voir ces deux stars s’impliquer à ce point dans une scène dont la vigueur évoque une autre poursuite dans un chantier, celle du James Bond « Casino Royale » (Martin Campbell, 2006). Et lorsque, cerise sur le gâteau, la musique de Jerry Fielding, avec ses envolées jazzy, ses percussions endiablées et ses thèmes déconstruits accompagne l’action, on s’étonne d’être encore cloué à son canapé par un vieux polar de 1973 sans effets spéciaux. Et l’on s’étonnera plus encore de cette fin particulièrement inattendue…
Les années 70 sont de loin la période la plus intéressante dans la carrière de ce cinéaste un peu sous-estimé que fut Michael Winner (décédé en 2013). Comme souvent avec lui, il est question de survie, de solitude et de vengeance dans un monde un peu décadent et amoral. Une préoccupation qui trouvera son apogée dans « Le justicier de minuit » (1974) et ses suites. Mais si son précédent film, « Le flingueur », plus cérébral (pour un polar avec Bronson) montrait son goût pour l’expérimentation avec ces angles un peu bizarres et ces vingt premières minutes sans un mot, « Scorpio » est plus épuré et d’une facture plus classique tout en brillant par son réalisme, son rythme et son casting cinq étoiles. C’est probablement avec l’un de ces deux films qu’il faudrait découvrir ou redécouvrir le cinéma de Michael Winner.
Scorpio / Michael Winner / Sortie : 1973 / 114 mn.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.
En 2025, nous faisons face à trois menaces :
- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.
- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.
- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.
Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !







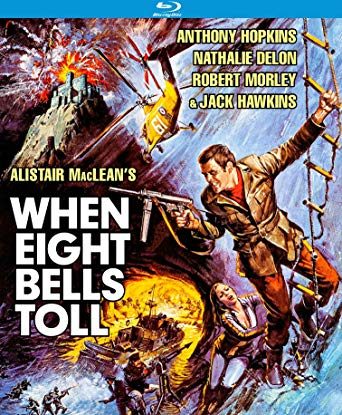

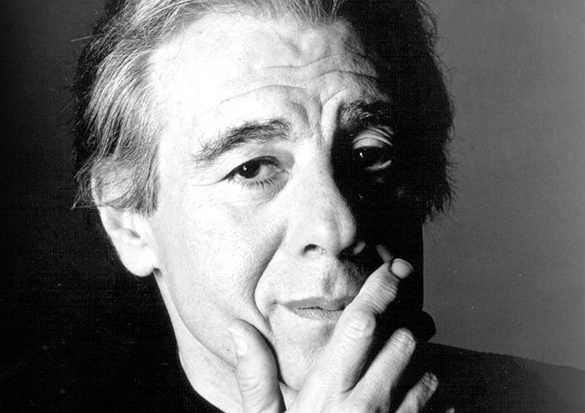

Chargement des commentaires…