Tim Kreider écrit pour le New York Times et d’autres journaux. Son recueil, We Learn Nothing est paru en 2011 chez Simon & Schuster. (Sinon, dans une première carrière, il a été cartooniste, et là aussi il était très fort : plusieurs recueils de ses dessins sont publiés chez Fantagraphics.)
« Les gens sont débordés. Si vous vivez ici et maintenant, vous ne risquez pas de l’ignorer. C’est devenu la réponse par défaut quand on demande à quelqu’un comment ça va :
« Débordé ! Complètement overbooké. C’est la folie. »
Évidemment, il s’agit moins de se plaindre que de se faire mousser. D’ailleurs on y répond presque toujours sur le ton de la flatterie :
« Vaut toujours mieux ça que l’inverse. »
Ou :
« Ça, c’est la rançon de la gloire. »
Notez bien qu’en général ces gens débordés n’enchaînent pas les gardes dans une unité de soins intensifs. Ils ne vont pas non plus en bus d’un petit boulot sous-payé à un autre : ceux-là, ils ne sont pas débordés, ils sont fatigués. Épuisés. Morts. Ceux qui sont débordés, eux, l’ont presque toujours choisi.
Ils ont voulu le travail et les obligations qu’ils se sont imposés, les cours et les activités auxquels ils ont encouragé leurs enfants à participer. Ils sont débordés parce qu’ils le veulent — par ambition ou par angoisse. Ils sont drogués à la suractivité et terrifiés à l’idée de ce qu’il se passerait si ça s’arrêtait.
Presque tous les gens que je connais sont débordés
Presque tous les gens que je connais sont débordés. Ils se sentent angoissés et coupables dès qu’ils ne sont plus en train de travailler ou de promouvoir leur travail. Quand ils consacrent du temps à leurs amis, ils le font comme de bons élèves font du bénévolat, parce que ça fait bien sur un CV.
Il n’y a pas longtemps, j’ai proposé à un copain qu’on se voie un jour dans la semaine. Il m’a répondu qu’il n’avait pas trop de temps mais de l’appeler si je faisais un truc : il arriverait peut-être à dégager quelques heures. J’ai failli lui dire que ma question n’était pas le préliminaire à une invitation mais l’invitation elle-même. Mais bon, il aurait fallu crier tellement fort pour qu’il m’entende par-dessus le bruit de son agitation que j’ai laissé tomber.
Même les enfants sont débordés, aujourd’hui. Entre l’école et les activités extra-scolaires, leur journée est réglée à la demi-heure. Quand ils rentrent le soir, ils sont épuisés comme des adultes. De mon temps, les enfants avaient leur clef et rentraient seuls après les cours. C’est comme ça que j’ai bénéficié de trois heures quotidiennes complètement libres, et le plus souvent sans surveillance.
J’en ai profité pour faire à peu près tout et n’importe quoi : lire l’encyclopédie, bricoler des films d’animation, aller retrouver les copains dans les bois pour des batailles de mottes de terre. J’ai cultivé des dons et un regard sur le monde qui sont encore les miens aujourd’hui.
Notre hystérie contemporaine n’est pas une fatalité, ce n’est pas une condition nécessaire de l’existence. Nous y avons consenti — voire, nous l’avons cherchée. L’autre jour, je discutais sur Skype avec une amie que la hausse des loyers a chassée de New York et qui est en ce moment en résidence d’artiste dans une petite ville du sud de la France. Pour la première fois depuis des années, elle se dit heureuse et détendue.
Elle travaille mais son travail n’occupe plus tout son temps ni toutes ses pensées, elle a un cercle d’amis qu’elle voit tous les jours (ça lui rappelle la fac), elle a retrouvé une vie sentimentale (elle qui à New York avait jeté l’éponge avec ces termes désabusés : tout le monde est débordé et tout le monde pense qu’il peut trouver mieux). Elle a compris que ce qu’elle prenait pour des traits de son caractère (carriérisme, angoisse, mauvaise humeur, mélancolie), n’étaient en fait que des conséquences de son environnement. Ce n’est pas comme si on décidait délibérément de vivre dans un climat de tension et de compétition permanentes.
Personne ne choisit de vivre comme ça, de même que personne ne choisit d’être coincé dans un embouteillage, piétiné par la foule dans un stade ou souffre-douleur du lycée. C’est quelque chose que nous nous imposons les uns aux autres, collectivement.
Être débordé, c’est une assurance contre le vide existentiel
Être débordé, c’est une assurance contre le vide existentiel. Comment est-ce que votre vie pourrait être banale, insignifiante ou dépourvue de sens si vous êtes complètement débordé, occupé 24h/24, sollicité de toutes parts ? Je ne peux pas m’empêcher de me demander si toute cette agitation histrionique ne sert pas juste à cacher que bien souvent, ce que nous faisons n’a aucune importance.
J’ai connu une fille, en stage dans un magazine, qui n’avait pas le droit de sortir pour sa pause déjeuner, au cas où on aurait eu besoin d’elle pour une urgence. Il est quand même difficile de ne pas voir ce genre de situations comme une forme d’autosuggestion généralisée — surtout dans ce cas précis, puisqu’il s’agissait d’un magazine télé, dont on se demande bien à quoi ils servent depuis qu’il y a des boutons MENU sur les télécommandes.
Si je me fie au nombre d’e-mails et de LOLcats que je reçois tous les jours, je soupçonne que la plupart des gens qui ont des jobs de bureau n’en font pas beaucoup plus lourd que moi. On est tous hyper débordés, d’accord, mais qu’est-ce qu’on produit, au juste ? Tous ces gens qui finissent à pas d’heure, qui sont coincés en réunion et qui hurlent dans leur portable, ils ne sont pas en train de combattre la malaria, de développer des alternatives crédibles aux énergies fossiles ou d’amener un peu de beauté sur cette terre, si ?
Je ne suis pas débordé. De tous les gens que je connais et qui ont un peu d’ambition, je suis de loin le plus paresseux. Comme la plupart des écrivains, si je n’écris pas, j’ai l’impression d’être un déviant qui ne mérite pas de vivre un jour de plus. Mais je considère aussi que quatre ou cinq heures suffisent. Une journée satisfaisante, pour moi, c’est une journée où j’écris le matin, où je fais une longue balade à vélo l’après-midi, puis quelques courses avant de voir des amis, de lire ou de regarder un film le soir. C’est un rythme qui me paraît sain et plaisant.
Et si on m’appelle pour me proposer de visiter la nouvelle aile du musée d’art contemporain, d’aller reluquer les filles à Central Park ou de passer le reste de la journée à boire des cocktails fluo, je lâche ce que j’étais en train de faire et je réponds : On se retrouve où ?
Mais ces derniers mois, sans m’en rendre compte, j’ai commencé à me laisser déborder par toutes sortes d’obligations professionnelles. Pour la première fois, j’ai pu dire sans mentir que je n’avais pas le temps de faire telle ou telle chose. Je comprends mieux pourquoi les gens aiment être débordés : on se sent important, recherché, exploité à sa juste valeur. Sauf que j’ai vite détesté être débordé. Tous les matins, je retrouvais ma boite mail bourrée de sollicitations diverses et de problèmes à résoudre.
La situation est devenue de plus en plus pénible, jusqu’à ce que je finisse par quitter la ville pour m’installer dans le refuge secret depuis lequel je vous écris.
Ici, je ne me laisse plus matraquer par mon agenda. Il n’y a pas de télévision. Pour relever mes mails, je dois aller à la bibliothèque en voiture. Il peut se passer une semaine entière sans que je voie quelqu’un que je connais. Les renoncules, les punaises et les étoiles se sont rappelées à moi. Je lis. Et pour la première fois depuis des mois, je suis content de ce que j’écris. Parce qu’il est difficile d’avoir des choses à dire sur la vie si on n’est pas immergé dans le monde — mais si on ne lui tourne pas le dos de temps en temps, il est à peu près impossible de savoir quelles choses, et comment les dire.
Se ménager du temps pour l’inaction, ce n’est pas seulement s’accorder des vacances, se laisser aller ou céder à la paresse. Le cerveau a autant besoin d’oisiveté que le corps de vitamine D. Sans elle, nous souffrons d’une maladie mentale aussi invalidante que le rachitisme. L’espace et la paix qu’elle procure sont indispensables pour prendre de la hauteur et voir la vie dans son ensemble, trouver des liens surprenants entre les choses et attendre ces éclairs dans un ciel d’été que sont les inspirations. C’est un paradoxe, mais sans oisiveté, rien ne se fait.
L’histoire est pleine de ces récits où l’inspiration frappe dans des moments d’indolence et de rêve : l’Eureka d’Archimède, la pomme de Newton, la découverte de la structure cyclique du benzène. On se demanderait presque si ce ne sont pas les tire-au-flanc et les glandeurs qui sont, bien plus que les bosseurs, à l’origine des chefs-d’œuvre, des inventions et des idées qui ont changé le monde.
Si tout le monde vivait comme moi, la civilisation courrait sans doute très vite à sa perte
Notre objectif pour le futur est la pleine inactivité, qu’on puisse enfin se consacrer au jeu. C’est pour cela qu’il faut détruire le système politique et économique actuel. Ce n’est pas un anarchiste fumeur de bong qui parle mais Arthur C. Clarke, qui entre la plongée sous-marine et le flipper a trouvé le temps d’écrire Les Enfants d’Icare et d’imaginer les communications par satellite. Certains pensent qu’il serait temps de séparer l’idée de travail de celle de revenu — que chaque citoyen puisse compter sur un revenu garanti indépendamment du travail qu’il fournit.
Ça ressemble à d’autres idées qui ont d’abord paru saugrenues et qu’un siècle plus tard on considère comme des droits de l’homme : l’abolition de l’esclavage, le suffrage universel, la journée de huit heures. Je sais que c’est un peu hérétique pour un Américain, mais je ne vois pas pourquoi on ne considérerait pas le labeur comme un fléau à éradiquer, au même titre que la polio. Manifestement, les puritains qui ont fait du travail une vertu ont oublié que Dieu l’avait inventé pour nous punir.
Si tout le monde vivait comme moi, la civilisation courrait sans doute très vite à sa perte. Mais peut-être que le modèle idéal de société se trouve quelque part entre ma nonchalance revendiquée et l’agitation en vigueur. Moi ma position, c’est celle de l’élément perturbateur : celui qui vous fait des grimaces derrière la vitre alors que vous êtes à votre pupitre, qui vous presse de trouver une excuse et de venir jouer dehors, pour une fois.
Je me réserve du temps pour ne rien faire, et c’est un luxe plus qu’une vertu. Mais entre le temps et l’argent, j’ai choisi le temps, et ceci en toute conscience. Car j’ai toujours été persuadé que ce que j’avais de mieux à faire de mon passage sur cette terre, c’était de profiter des gens que j’aime. Il n’est pas impossible que sur mon lit de mort, je regrette de ne pas avoir travaillé un peu plus, de ne pas avoir dit tout ce que j’avais à dire. Mais je pense que ce que je regretterai surtout, c’est de ne pas avoir pris une dernière bière avec Chris, refait le monde avec Megan ou ri avec Boyd une dernière fois. La vie est trop courte pour être débordé. »
Traduit de l’anglais par Nils C. Ahl
Deux textes longs de Tim Kreider : On croit connaître les gens et Les gens lucides sont toujours seuls.
Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.
En 2025, nous faisons face à trois menaces :
- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.
- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.
- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.
Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

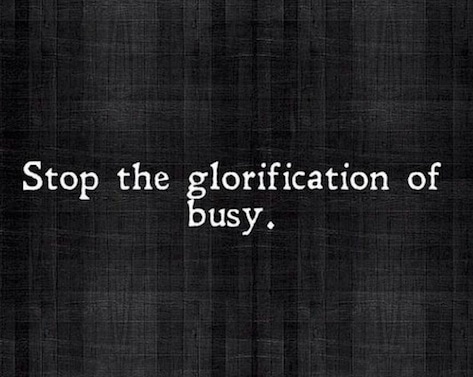
Chargement des commentaires…